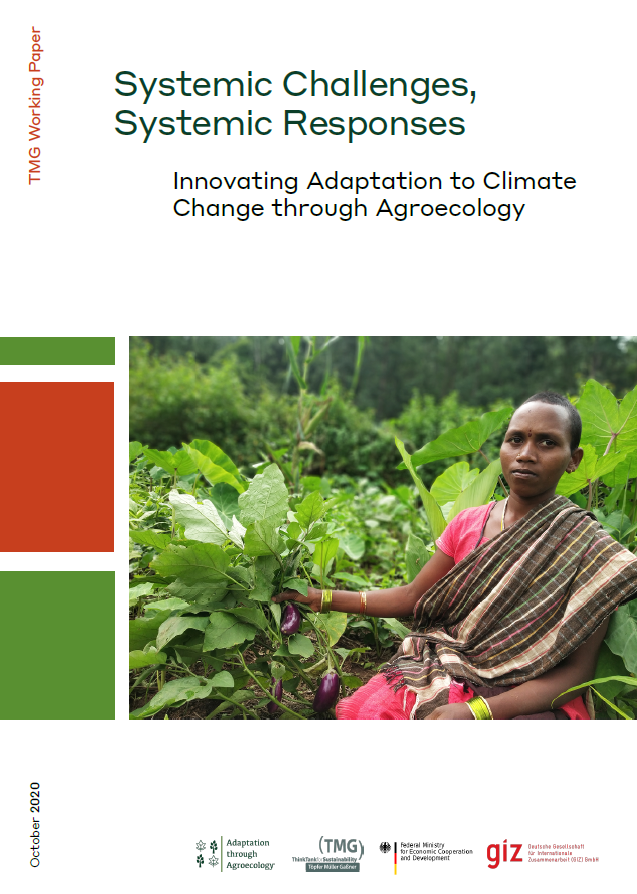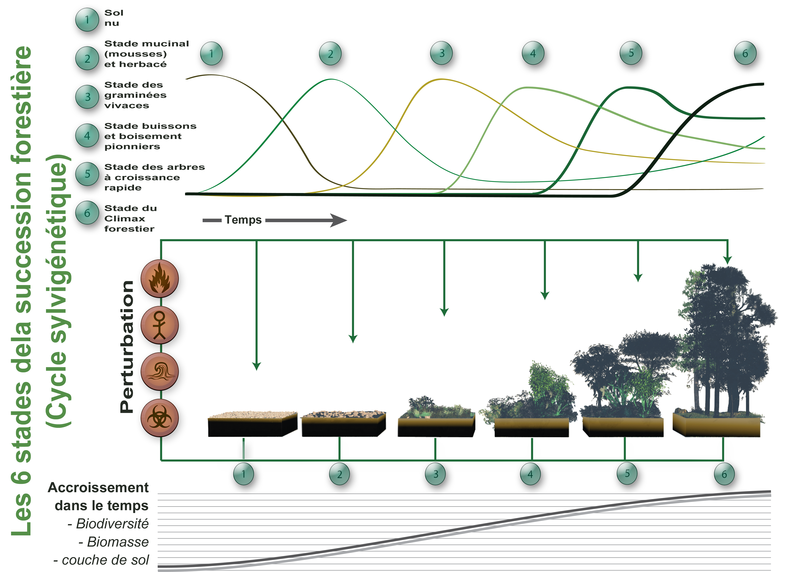J’ai participé cette année en tant qu’expert scientifique, pour le compte de l’association Biovallée, à un travail d’échange animé par l’ONG TMG Research entre acteurs locaux des questions de sécurité alimentaire du monde entier, ONGs et chercheurs, qui a conduit à la rédaction collective d’un rapport sur la place de l’agroécologie dans les stratégies d’adaptation au réchauffement climatique. Je vous propose ici la lecture de la traduction de l’article publié par TMG-Think Tank for Sustaniability à l’occasion de la publication du rapport éponyme.
Les liens vers le rapport complet (en anglais) ainsi que les études de cas (dont celle de Biovallée, en anglais égalgement) se trouvent à la fin de l’article.
« Cultivez, nourrissez, soutenez. Ensemble. »
Nous vivons une époque sans précédent. Il n’est donc pas étonnant que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) appelle à autre chose qu’une action ordinaire alors que nous commémorons la Journée mondiale de l’alimentation de cette année.

2020 restera ancrée dans notre mémoire collective alors que l’année où la pandémie a changé notre monde. Le COVID-19 a gravement affecté la vie et la santé des personnes sur tous les continents, a montré les faiblesses de nos systèmes de santé et démontré à quel point les vulnérabilités de notre monde sont interconnectées. Pour certains, le «travail à domicile» a été un moment de paix et de réflexion bienvenu, pour beaucoup il a apporté de nouveaux défis de combiner travail, scolarisation à domicile des enfants tout en vivant dans de petits appartements. Mais pour des milliards de personnes sans filet de sécurité sécurisé, en particulier dans les pays du Sud et dans les pays industrialisés sans filets de sécurité sociale solides, cela a entraîné une peur et une incertitude croissantes, la perte de moyens de subsistance et la perspective très réelle d’une faim croissante.
Même avant la pandémie, nos systèmes alimentaires étaient déjà confrontés à un stress sévère en raison des impacts du changement climatique accéléré et du manque de volonté de transformer fondamentalement les systèmes économiques qui continuent de saper la base même de notre survie. En ce sens, cette Journée mondiale de l’alimentation 2020 pourrait devenir un test de notre détermination à véritablement sauvegarder le droit humain à l’alimentation.
La faim augmente
L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2020 a signalé que 690 millions de personnes – près de 9% de la population mondiale – souffraient de sous-alimentation chronique en 2019. Ces chiffres contrastent fortement avec l’augmentation significative de la production alimentaire dans la plupart des régions du monde au cours des cinq dernières décennies. Ce que cela nous dit, c’est que l’augmentation de la production alimentaire ne s’est pas traduite par une sécurité alimentaire pour tous. Le Rapport mondial sur les crises alimentaires 2020 a signalé le plus grand nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire aiguë jamais enregistré en 2019. 135 millions de personnes dans 55 pays et territoires avaient besoin d’une aide alimentaire urgente en raison de conflits, de conditions météorologiques extrêmes, d’épidémies de ravageurs ou de chocs économiques. L’analyse mise à jour de septembre 2020 sur la sécurité alimentaire en période de COVID-19 met en évidence que la pandémie a eu un effet aggravant sur les facteurs préexistants de l’insécurité alimentaire, principalement en raison du déclin de l’activité économique. Il révèle en outre que de nombreuses mesures prises pour empêcher la propagation du COVID-19 ont provoqué un choc soudain sur les moyens de subsistance dans les zones urbaines. Alors que les effets pour les ménages agricoles ont été moins immédiats, le plein impact devrait continuer à se manifester par une catastrophe à évolution lente au cours des prochaines saisons agricoles, en fonction de nouvelles perturbations des chaînes d’approvisionnement et des systèmes alimentaires.
Nos systèmes alimentaires: face à de multiples crises
Nos systèmes alimentaires ne sont pas équipés pour faire face aux défis croissants que le changement climatique leur pose; encore moins pour faire face à plusieurs crises à la fois. En fait, les systèmes alimentaires actuels sapent la base même de leur propre résilience. Si la modernisation de l’agriculture a contribué à augmenter les rendements, elle est également reconnue comme un contributeur majeur à la dégradation des écosystèmes naturels et des divers services écosystémiques qu’ils fournissent. Il existe des preuves accablantes que les modèles de production agricole actuels accélèrent la perte de biodiversité et sont responsables de la majorité des émissions de gaz à effet de serre résultant du changement d’utilisation des terres, de la dégradation des terres et de l’utilisation non durable des ressources en eau douce.
Le changement climatique, à son tour, ajoute encore aux risques pour nos systèmes alimentaires. Des régimes pluviométriques plus irréguliers, des événements météorologiques extrêmes plus fréquents, la hausse des températures ont tous un impact sur la capacité de nos systèmes alimentaires à continuer à produire des récoltes suffisantes pour nourrir le monde. Si les taux actuels d’émissions de gaz à effet de serre se maintiennent, on estime que d’ici 2050, il y aura une baisse moyenne de 17% de la production de quatre grandes cultures céréalières qui fournissent la nourriture de base à des milliards de personnes (céréales secondaires, graines oléagineuses). , blé et riz).
Le statu quo n’est plus une option. L’urgence et la complexité des défis auxquels nous sommes confrontés appellent des solutions audacieuses et innovantes. Nous devons surmonter la vieille compréhension selon laquelle des innovations technologiques étroites ne s’adressant qu’à de petits segments des systèmes éco-agroalimentaires complexes fournissent les solutions nécessaires. Le changement climatique affecte toutes les parties de notre système alimentaire et nécessite une réponse systémique. Sinon, les externalités négatives de l’action dans un secteur pourraient avoir un impact négatif sur un autre. Nous proposons de combiner les principes agroécologiques avec l’innovation sociale et les technologies appropriées pour relever les défis qui nous attendent de manière systémique.
L’agroécologie: une solution innovante à des défis complexes
Les impacts du changement climatique sur les systèmes alimentaires sont complexes et posent des défis au système dans son ensemble. Une crise sanitaire mondiale sans précédent a révélé de nouvelles vulnérabilités de nos systèmes alimentaires en restreignant considérablement l’accès à la nourriture, à la fois en raison du verrouillage et de la perte de sources de revenus pour beaucoup (voir ici et ici).

Assurer une réponse appropriée à une crise alimentaire qui s’aggrave, qui affecte de manière disproportionnée des groupes de population déjà vulnérables (voir ici et ici), appelle à une action déterminée sur le changement climatique. Cela signifie que nos programmes d’adaptation et d’atténuation du changement climatique doivent prendre en compte la complexité des défis sous-jacents. Au cœur de cette réponse systémique se trouve un besoin urgent de renforcer la résilience des petits agriculteurs, des sans terre, des migrants, des citadins pauvres et d’autres groupes vulnérables, pour résister aux multiples crises auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui. L’agroécologie offre une réponse d’adaptation systémique qui va au-delà des solutions technologiques pour s’attaquer aux moteurs sociaux et économiques sous-jacents qui contribuent à l’insécurité alimentaire.
Innover l’adaptation grâce à l’agroécologie
Afin d’explorer les promesses de l’agroécologie en ces temps incertains, TMG Research et ses partenaires ont convoqué un vaste processus de consultation qui a passé en revue les preuves disponibles sur la contribution de l’agroécologie à l’adaptation au changement climatique et à la résilience*. le lien qu’il établit entre la production alimentaire et le capital naturel et social sous-jacent qui sous-tend les systèmes alimentaires résilients. Les consultations ont conclu que l’agroécologie offre donc une solution concrète aux besoins d’adaptation d’aujourd’hui en encourageant des solutions locales pour une meilleure résilience. Les participants ont en outre souligné que, compte tenu de la dynamique complexe et spécifique au contexte entre le changement climatique et les systèmes alimentaires, il est nécessaire d’adapter à la fois la recherche et les investissements à différents contextes. Cela nécessite également de reconnaître la contribution des différents systèmes de connaissances dans la recherche de solutions appropriées, en particulier au niveau local.
Publié aujourd’hui, le document de travail qui en résulte «Défis systémiques, réponses systémiques: Innover l’adaptation au changement climatique grâce à l’agroécologie» présente un ensemble de messages clés qui ont émergé de ces consultations:
1. Pour être innovants, les efforts d’adaptation doivent répondre aux défis systémiques posés par le changement climatique à nos systèmes alimentaires.
2. Les divers systèmes agricoles sont moins vulnérables aux événements climatiques extrêmes, à la variabilité du climat et aux changements agro-climatiques cumulatifs.
3. Pour renforcer la capacité d’adaptation des moyens de subsistance ruraux, il est nécessaire de coupler les innovations technologiques et les améliorations des pratiques agricoles, avec des investissements dans le capital social, la co-création de connaissances avec les agriculteurs, de nouveaux réseaux de commercialisation et une gouvernance responsable des terres et des ressources naturelles.
4. Des approches de mesure intégrées, telles que la véritable comptabilité analytique, sont nécessaires pour saisir tous les facteurs qui contribuent à la résilience des systèmes alimentaires au climat.
5. Innover pour s’adapter au changement climatique ne demande rien de moins que de transformer nos systèmes alimentaires.
Ces messages soulignent le besoin urgent d’investir dans des réponses systémiques pour transformer nos systèmes alimentaires, y compris des investissements dans un environnement favorable qui permet aux innovations technologiques et sociales de profiter aux communautés en situation d’insécurité alimentaire.
*Le processus de consultation a été financé et mis en œuvre au nom du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) et de l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ).
Pour en savoir plus sur les problèmes mis en évidence lors des consultations, ainsi que sur les preuves sous-jacentes à ces messages, consultez le document complet ici. Nous avons également publié ici une série d’études de cas sur des initiatives réussies.
Pour participer à nos discussions sur la sécurité alimentaire et Covid-19, suivez-nous sur Twitter: https://twitter.com/CovidFoodFuture