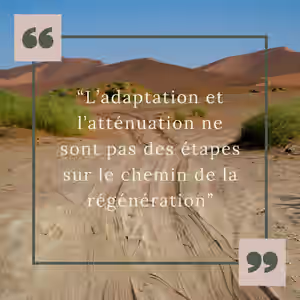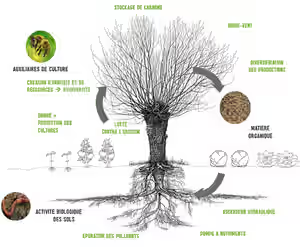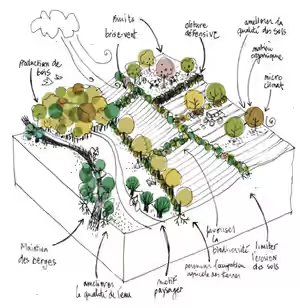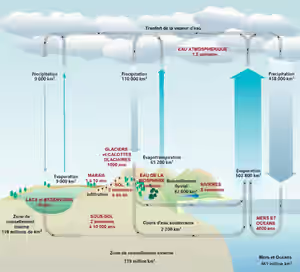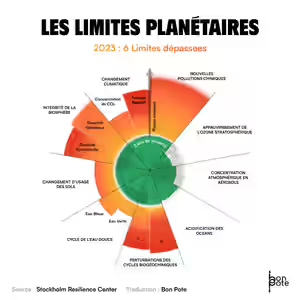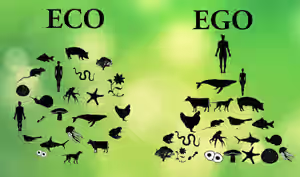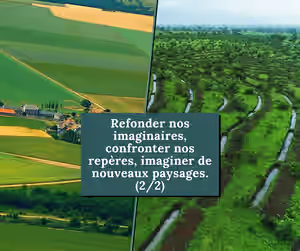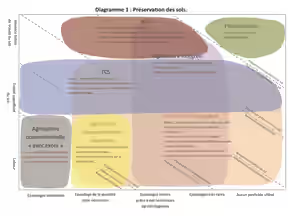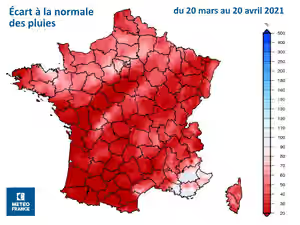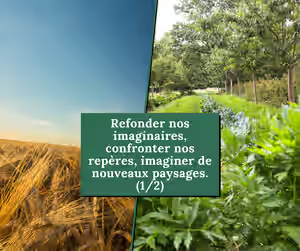Dès les premières pages, le décor est planté. Le danger rôde et se rapproche. Lointain, mais est-il réel ? Le doute s’installe. Le lecteur sent monter la pression, et se délecte par avance de la perspective des inévitables rebondissements, qui seront aussi épiques que tragiques. La ficelle est bien connue, et les romanciers en usent et en abusent pour bâtir leurs intrigues. A l’image du Seigneur des Ténèbres dont l’annonce du retour se fait sentir dès le premier tome de la saga Harry Potter, ou de la lointaine (mais bien réelle) menace que représentent les marcheurs blancs venus du Nord dans la série Game of Thrones, les alertes des scientifiques sur les changements climatiques ont égrainé notre actualité depuis maintenant 45 ans (et même depuis 1896 si on remonte à la première prédiction par le chimiste suédois Svante Arrhenius), d’abord dans l’indifférence générale, et aujourd’hui dans un climat de tension de plus en plus grand, entre dénialisme, rassurisme, éco-anxiété et appels à l’action de plus en plus désespérés.
Peu enclins à changer leurs habitudes, pétris de confiance en la technologie pour se sortir de ce mauvais pas, les humains ont traîné les pieds, résistant aux premières tentatives lancées au nom des « générations futures » par quelques courageux éclaireurs de faire émerger des modes de vie plus durables, pestant contre l’ « écologie punitive », râlant contre ces insupportables « privations de liberté ». Et puis de toute façon, « ce n’est pas notre affaire, allez demander aux chinois de moins polluer », et laissez nous consommer tranquillement (des produits importés de Chine). Fin de l’histoire.
Face au déni climatique, l’adaptation et l’atténuation comme nouveaux horizons politiques ?
Et puis l’histoire a basculé, et les changements climatiques sont devenus bien plus réels, bien plus palpables, bien plus concrets, impactant de plus en plus sérieusement la rentabilité de notre économie mondialisée. Une bataille a commencé à s’installer, entre ceux qui souhaitent maintenir le cap coûte que coûte, quitte à gangrener la société de leurs discours populistes (nul besoin d’aller jusqu’à Trump, il suffit en France de lire la récente lettre de Laurent Wauquiez aux agriculteurs), et une partie (croissante?) de la population convaincue que la situation est grave, et qu’il est temps de « faire quelque-chose ».
Mais que faire ? Dans quelle(s) direction(s) orienter nos efforts ? Les appels à l’action se multiplient, et trouvent une caisse de résonance dans l’accumulation de centaines de livres, documentaires, films, émissions de radio ou podcasts consacrés aux changements climatiques et à la nécessaire transition écologique de nos sociétés.
Pour le moment les initiatives portées ici et là par l’Etat, les collectivités territoriales, ou les entreprises (dans le cadre de leur plan RSE), tendent pour l’essentiel à répondre à une seule et même question, qui résume parfaitement de mon point de vue le paradigme de l’adaptation : « Comment garantir le maintien de nos activités dans le contexte des changements climatiques actuels ? ». Elles s’accompagnent de mesures dites d’ « atténuation », qui rassemblent toutes les actions visant à « réduire, éviter et compenser » les émissions de gaz à effet de serre.